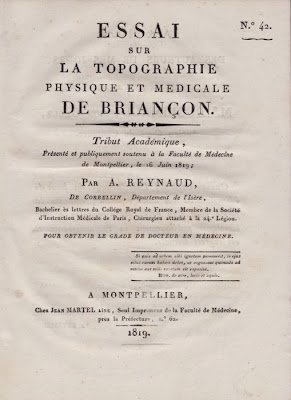En 1844, paraît Idiomologie des animaux, ou Recherches historiques, anatomiques, physiologiques, philologiques, et glossologiques sur le langage des bêtes, livre qui contient un fort riche et intéressant « glossaire ouistiti ». L'auteur est un médecin polygraphe Claude-Charles Pierquin de Gembloux (Bruxelles 1798 - Paris 1863) : « Sa bibliographie forme à elle seule un magnifique poème où se mêlent, s'affrontent et se complètent l'histoire, l'archéologie, la numismatique, la philologie, la pédagogie, la médecine, l'hygiène, la poésie. » Membre d'une cinquantaine de sociétés savantes françaises et étrangères, il publie plus de 160 ouvrages sur les sujets les plus divers.
![]()
Cet homme qui a vécu quelques années à Grenoble (il s'y est marié en 1832) ne pouvait pas ne pas appliquer sa fièvre d'écriture à des sujets dauphinois. C'est à ce titre qu'il publie à Grenoble en 1837 un petit opuscule
Lettre à M. Gautier, conseiller de préfecture des Hautes-Alpes, sur les antiquités de Gap. En ces années-là, Théodore Gautier rassemble les éléments d'un histoire de la ville de Gap qu'il publiera en 1844. Ainsi, il se rapproche des érudits et des spécialistes, ou ceux qu'il pense être spécialistes. Il est mis en relation avec Pierquin de Gembloux. Comme résultat, celui-ci lui livre une étude sur Gap où, de conjectures en hypothèses, il arrive à l'exposé de 9 propositions sur l'histoire antique de Gap et son étymologie toutes plus fantaisistes les unes que les autres, le tout avec une apparence de grand logique et d'érudition (pour en savoir plus,
cliquez-ici)
![]()
Pour donner un exemple, il arrive à la conclusion que Gap a eu deux noms, l'un mystérieux et sacré, Tricorium, l'autre profane, Kapodunum. Quand on sait que le nom antique de Gap est Vappincum, ce qui était déjà bien connu à l'époque, on voit qu'il lui a fallu parcourir du chemin pour arriver à ces noms recréés. Autre exemple, il arrive à reconstituer les armoiries antiques de la ville, son emplacement, son antiquité, etc., le tout à partir du nom d'un lieu-dit moderne, Capadoce, et de quelques découvertes archéologiques.
Le plus étonnant est que Théodore Gautier a repris ces conclusions dans son livre, preuve des lacunes dans sa culture historique. Un de ses contemporains, le bibliophile et bibliographe
Colomb de Batines a tout de suite vu que tout cela n'avait aucune valeur historique. Dans son
Annuaire bibliographique du Dauphiné pour 1837, il affirme "cet opuscule, selon nous tout conjectural, et dont les conclusions sont, tout au moins, fort hasardées".
La fièvre polygraphe de Pierquin de Gembloux s'est exercée sur de nombreux autres thèmes dauphinois, dont il donne la liste dans la plaquette :
1reÉtude.—Lettres à M. Matter sur les Antiquités de Grenoble.
2e. — Lettre à M. de Coston sur un Monument de Théologie arithmétique existant à Valbonnais.
3e. — De la Mythologie du département de l'Isère.
4e. — Des différents noms portés par la rivière Isère dans l'antiquité.
5e. — Inductions philologiques sur Quintus Curtius Rufus.
6e. — Lettre à M. Gautier sur les Antiquités de Gap.
7e. — Géographie du Delta celtique.
8e. — Sur l'état de l'Art dramatique chez les Allobroges.
9e. — Histoire littéraire du Delta celtique.
10e.— Lettres sur quelques erreurs commises dans l'explication de certains monuments paléographiques du Delta celtique.
11e.— Des traces laissées par le phénicien, le punique, le grec et l'arabe dans les dialectes néo-latins du Dauphiné.
Même si rien ne l'indique, il s'agit probablement plus de projets que d'ouvrages réellement parus. Seuls quelques uns d'entre eux semblent avoir été publiés. Au CCFr, on trouve :
Lettres à M. Matter, membre de l'institut, sur les antiquités de Grenoble, Grenoble, Baratier frères et fils, 1836
Lettre sur un monument de théologie arithmétique, Grenoble, Baratier frères et fils, 1837.
Lettre à M. Cournot, recteur de l'académie de Grenoble, sur les différents noms donnés à la rivière Isère, Bourges, impr. de G. Ménacé (sic), s. d.
Ensuite, comme on l'a vu, il s'est penché sur d'autres sujets. Sur Pierquin de Gembloux, voir la notice
Wikipedia.
L'idée de ce billet m'est venu suite à échange récent avec Olivier Justafré, qui a fait paraître en 2011,
Graines de folie. Supplément aux Fous littéraires, aux éditions Anagrammes.
Il m'a ainsi fait découvrir quelques fous dauphinois comme Bobila ou Gaspard Godard, etc.
Dans cet ouvrage, se trouve référencé mon fou littéraire haut-alpin préféré : Jacques François Joseph Rochas, le juge auteur du
Nouveau pas sur les sentiers de la nature.... en 1808 (voir le message que je lui ai consacré :
Un fou littéraire haut-alpin).
Cela m'a amené à réfléchir à d'autres fous littéraires haut-alpins. J'ai évidemment pensé à Louis Manent, alias Théodore Mital avec son opuscule politique :
Faut-il fusiller 300 000 ouvriers en France? L'abolition des castes sociales. La méthode de travail. Les Eglises laïcisées. La libre pensée. La défense dans la République, paru à Guillestre vers 1906 (voir le message que je lui ai consacré :
Un message de circonstance !)
Plus original que fou à proprement parler, le sous-préfet Barthélemy Chaix a fait paraître un pavé en 1845, à 85 ans :
Préoccupations statistiques, géographiques, pittoresques et synoptiques du département des Hautes-Alpes.
Reconnaissance, topographie des diverses localités :
Mappe départementale. – Climatologie. – Minéralogie industrielle. – Orographie et géologie. – Géographie végétale. – Faune et anthropologie.
Ethnographie. – Condition rétrospective, l'historique du pays. – Economie départementale, etc. – Agronomie, agriculture. – Viabilité, communications. – Instituts de secours publics. – Contributions, charges publiques.
Grenoble, Typographie F. Allier, 1845, in-8°, 979-[5] pp., une planche gravée hors texte in fine.
C'est un ouvrage inclassable sur les Hautes-Alpes et, plus particulièrement, sur le Briançonnais. L'auteur aborde de façon désordonnée et foisonnante de nombreux aspects de la vie dans les Hautes-Alpes. Il est intéressant sur la diffusion du Fouriérisme parmi les élites du département. En effet, tout au long du livre, Chaix se fait l'apôtre de Fouriérisme comme solution aux problèmes des Alpes. Il voit en particulier la création de la communauté agricole comme une réponse aux problèmes les plus variés de l'agriculture, en particulier le déboisement.
Ce qui le rend original, c'est son style inimitable, aux comparaisons surprenantes. A titre d'illustration cette description du massif des Ecrins :
« En hiver, un œil d'aéronaute placé dans la verticale du zénith des Alpes dauphinoises, du Pelvoux, de la Vallouise par exemple, verrait un relief de belle porcelaine, avec des ombres purpurines, comme une étendue de feuilles roses blanches, avec reflets carminés.
Pendant l'été, ce même œil verrait d'une grande altitude une représentation de la lune dans le champ d'un télescope, à une moindre élévation un horizon de mer houleuse et à une certaine proximité un tas d'artichauds.»
A ma connaissance, c'est la seule fois où le massif des Ecrins a été comparé à un tas d'artichauts.
J'ai parcouru l'ensemble de ma bibliographie des Hautes-Alpes à la recherche d'autres fous littéraires. La moisson est pauvre. Le plus souvent, il s'agit plus d'originaux que de fous à proprement parler. D'ailleurs, plus généralement, c'est à mettre en rapport avec le peu de production littéraire dans le département. Peut-être que la montagne est plus propice aux préoccupations pratiques qu'aux œuvres d'imagination (il en faut presque en trop pour être un bon fou littéraire). On peut tout de même citer :
Ernest Chabrand (1850-1921), ingénieur des Arts et Métiers. Lorsqu'il s'aventure dans les recherches historiques, il arrive à des conclusions pour le moins surprenantes :
Origine étymologique et Signification du Nom de Gap, Grenoble, Xavier Drevet, Editeur, s.d. (1904) et
Le Bacchu-ber. Son origine – Signification de son nom, Grenoble, Xavier Drevet, Editeur, s.d. (1920). Remarquons au passage que les recherches étymologiques sont souvent un champ ouvert à l'imagination la plus débridée.
Le poète et boulanger briançonnais Jean-Pierre Cot (1810-1880) se fait le défenseur de l'emplacement de la gare de Briançon au Champ de Mars dans une petite plaquette :
Au conseil municipal de la ville de Briançon. Rapport sur le chemin de fer de Briançon et sur la nécessité de faire établir la gare militaire aux portes de la ville, Grenoble, Imprimerie de F. Allier père et fils, 1876. Il conclut : "le pays s'endort sur les bords d'un abîme", "ne demeurez pas sourds à cette voix qui vibre dans mon cœur de poëte, dans mon âme attristée et qui vient en ce jour vibrer à vos oreilles". Jean-Pierre Cot demanda et obtint une audience du Président de la République, Jules Grévy, pour défendre l'emplacement de la gare de Briançon au Champ de Mars. Jules Grévy l'écouta mais lui dit qu'il n'y pouvait rien (déjà !)
Il est aussi l'auteur de :
Les cloches du christianisme, poème historique et sentimental, Briançon, Chez l'auteur, 1859, in-12 °, 72 pp., publié à l'occasion d'une bénédiction de cloches à Briançon.
Michel B. Courtier :
Le vrai visage de Montgenèvre. Les messages de l'histoire, 1981, une étude sur le rôle de Montgenèvre comme lieu de passage et établissement humain depuis la préhistoire, tendant à transformer, à coups de phrase en capitales et caractères gras, ce modeste bourg, certes sur un col historique, en un lieu unique de l'histoire.
Je n'ai jamais vu cet ouvrage :
Recueil de chansons, par Jeanselme, boulanger à Embrun, Embrun, impr. de Jugy, (1874), mais il y a du potentiel.
De Grenoble à la Bérarde. Notice., par J. Massip, Chemisier à Grenoble, Rue Jean-Jacques Rousseau, Grenoble, Imprimerie Vallier Edouard, 1899 est un récit naïf, circonstancié et vivant d'une excursion (en tram, puis à pieds) de Grenoble à la Bérarde en juin 1897. La touche de fantaisie naïve n'en fait pas à proprement parler un fou littéraire, mais l'ouvrage est tout de même surprenant.
J'ajoute à la liste Victor Monard (1810-1867), poète local d'Orpierre (il se qualifie lui-même de "poète-naturel et troubadour des Alpes"), très largement oublié aujourd'hui alors qu'il a, le premier, publié des textes originaux en provençal haut-alpin (région d'Orpierre). Parmi les titres, il y a
L'Orpierréïde ou Les Amours de Tityre et d'Adèle, roman pastoral suivi des Aventures de plusieurs autres bergers et de la belle Dindonnière, Gap, impr. J. Allier, 1838 et
Les élections du pays de Cocagne, poème héroï-comique divisé en dix chants, suivi de l'Orpierréïde et de plusieurs pièces inédites, Carpentras, Imprimerie de Ve Proyet, 1846, un ensemble assez hétéroclite de poèmes en vers rimés, dans un style lourd, emphatique et souvent familier. Le premier poème conte les discordes municipales de Laragne, appelée Cocagne, dans les années 1830. Tous les noms cités sont fictifs, mais en partie identifiables. Le second poème, l'Orpierréïde, est une suite d'histoires de bergers d'Orpierre traitées à la manière antique.
René Ouvrard :
Merveilleuses Alpes dauphinoises. Tome II. Fascination des Fossiles. Recherches du Divin, Gap, Imprimerie Louis-Jean, 1984, un ouvrage au mysticisme exalté (et anti-évolutionniste), qui discourt sur des pierres aux formes étonnantes (des "fossiles" !) glanées au Lac des Solitudes, en face de la Meije. Le faux titre est "Les grands secrets alpins ? Ils siègent dans l'infini des temps !"
Le docteur Prompt qui imagine un train à crémaillère jusqu'au somme de la Meije (3987 m.) est plus un doux rêveur (mais à l'esprit pratique) qu'un fou :
Alpes dauphinoises. Hôtel et observatoire de la Meije. Altitude : 4.000 mètres, Grenoble, Imprimerie et lithographie F. Allier père et fils, 1894. Il y décrit un projet d'hôtel et d'observatoire au sommet de la Meije (« plus ou moins écrêtée ») auquel on accéderait par un train à crémaillère depuis la Grave, avec l'étude économique et de rentabilité du projet (déjà un Business Case !).
Le curé Jean Ranguis (1844 - ?) profite de ses monographies communales et historiques :
Notice historique sur la communauté d'Ancelles, où sont consignés les principaux évènements qui la concernent et pour en perpétuer le souvenir, Gap, Imprimerie L. Jean et Peyrot, 1899 et
Histoire du mandement de Montorcier, Grenoble, Imprimerie Vallier Edouard, 1905 pour faire preuve d'un militantisme clérical, au ton exalté (l'époque s'y prête !). Il publia des brochures contre le régime maçonnique et eut deux fois son traitement supprimé par la République.
Pour finir, je citerais deux personnalités. La première est un autre polygraphe, le jésuite Jean Joseph Rossignol (1726-1811), qui a laissé une masse impressionnante d'ouvrages sur à peu près tous les sujets. Ses œuvres complètes publiées à Turin remplissent 32 volumes. En cherchant bien, on doit bien trouver quelques perles, dans une telle production, d'autant plus qu'au moment de la Révolution, il s'est senti persécuté par ses compatriotes, l'obligeant à fuir précipitamment Embrun où il était professeur. On sait que ce type de mésaventure est propice à la folie littéraire....
L'autre personnalité est le grave et respectable
Antoine Français de Nantes dont les livres sont plein de fantaisie et d'invention, avec ce petit grain de folie qui n'en fait pas un fou littéraire, loin de là, mais qui réjouit le lecteur.
J'en ai déjà parlé, je renvoie à ce que j'en ai dit, surtout à cet ouvrage qui est celui que je préfère :
Le manuscrit de feu M. Jérome, contenant son œuvre inédite, une notice biographique sur sa personne, un fac similé de son écriture, et le portrait de cet illustre contemporain, Paris, 1825 (pour en savoir plus
cliquez-ici).